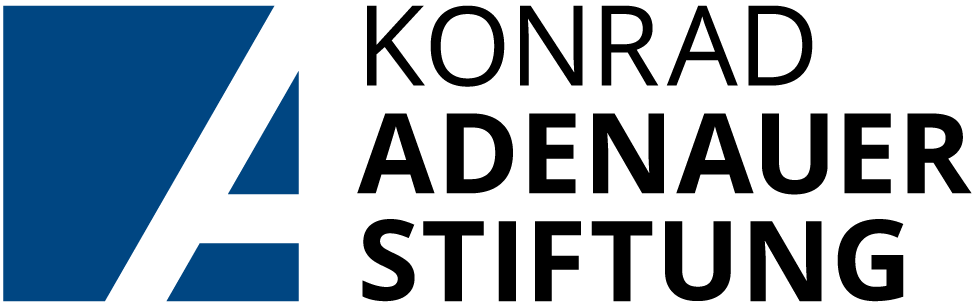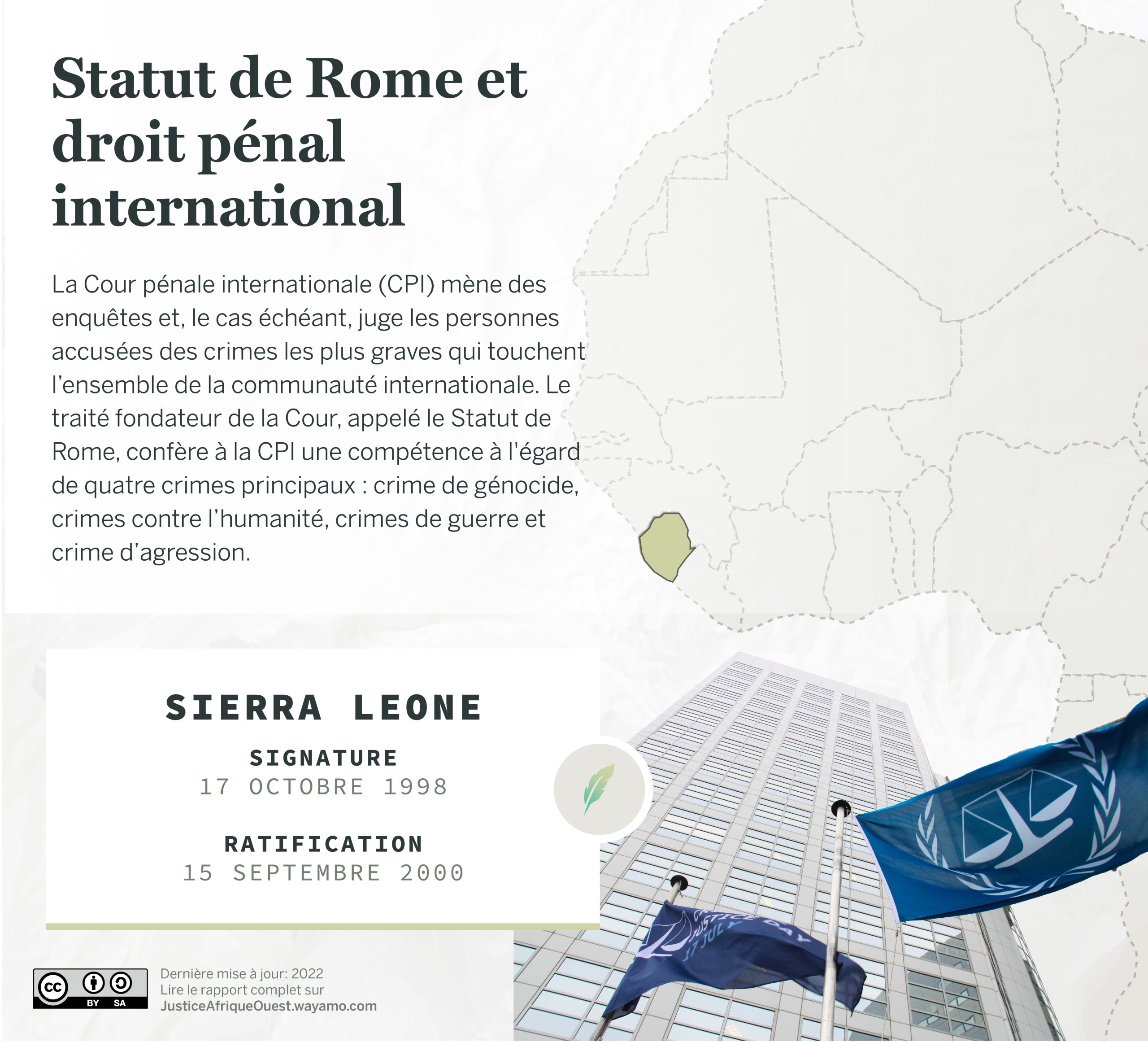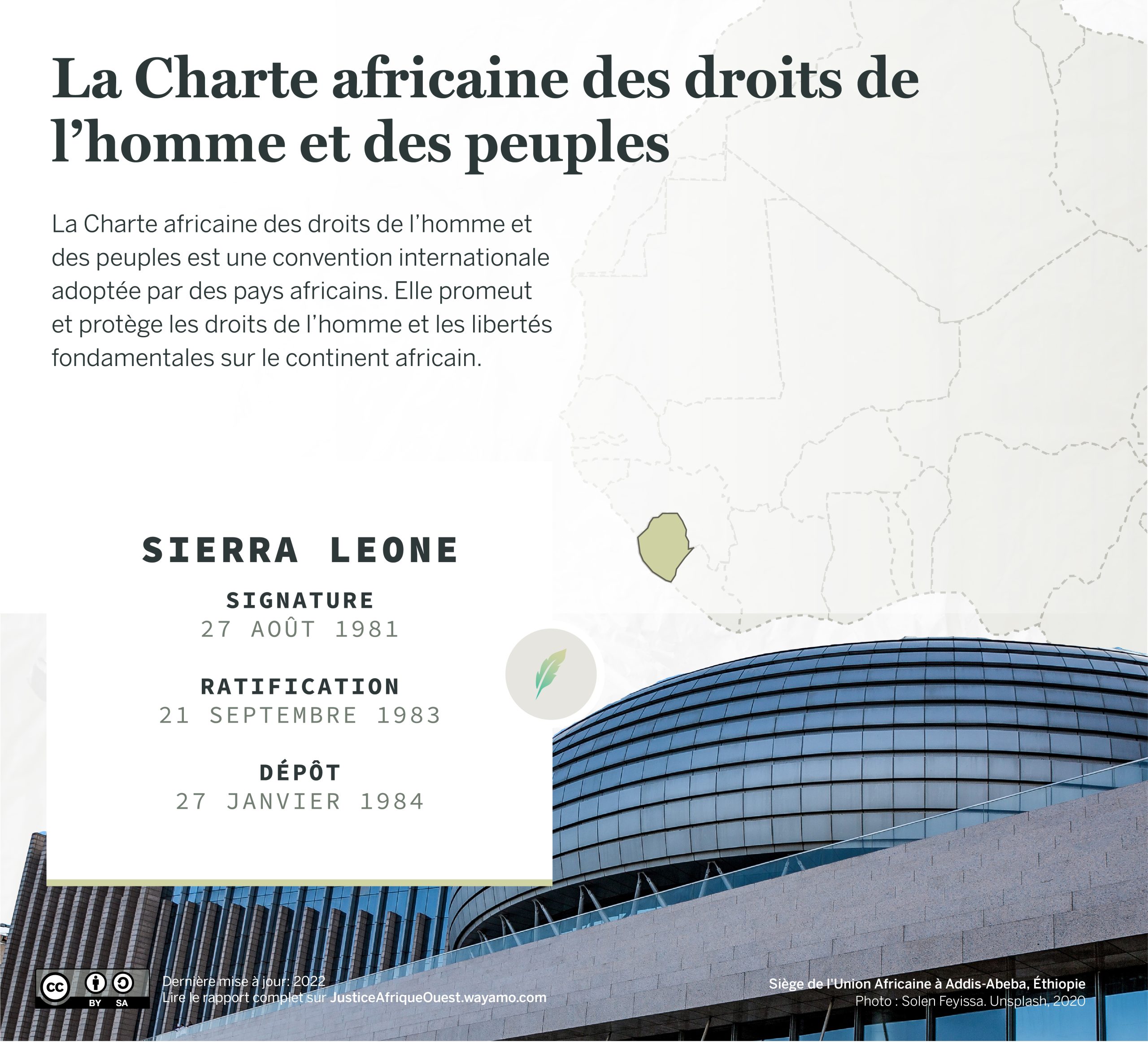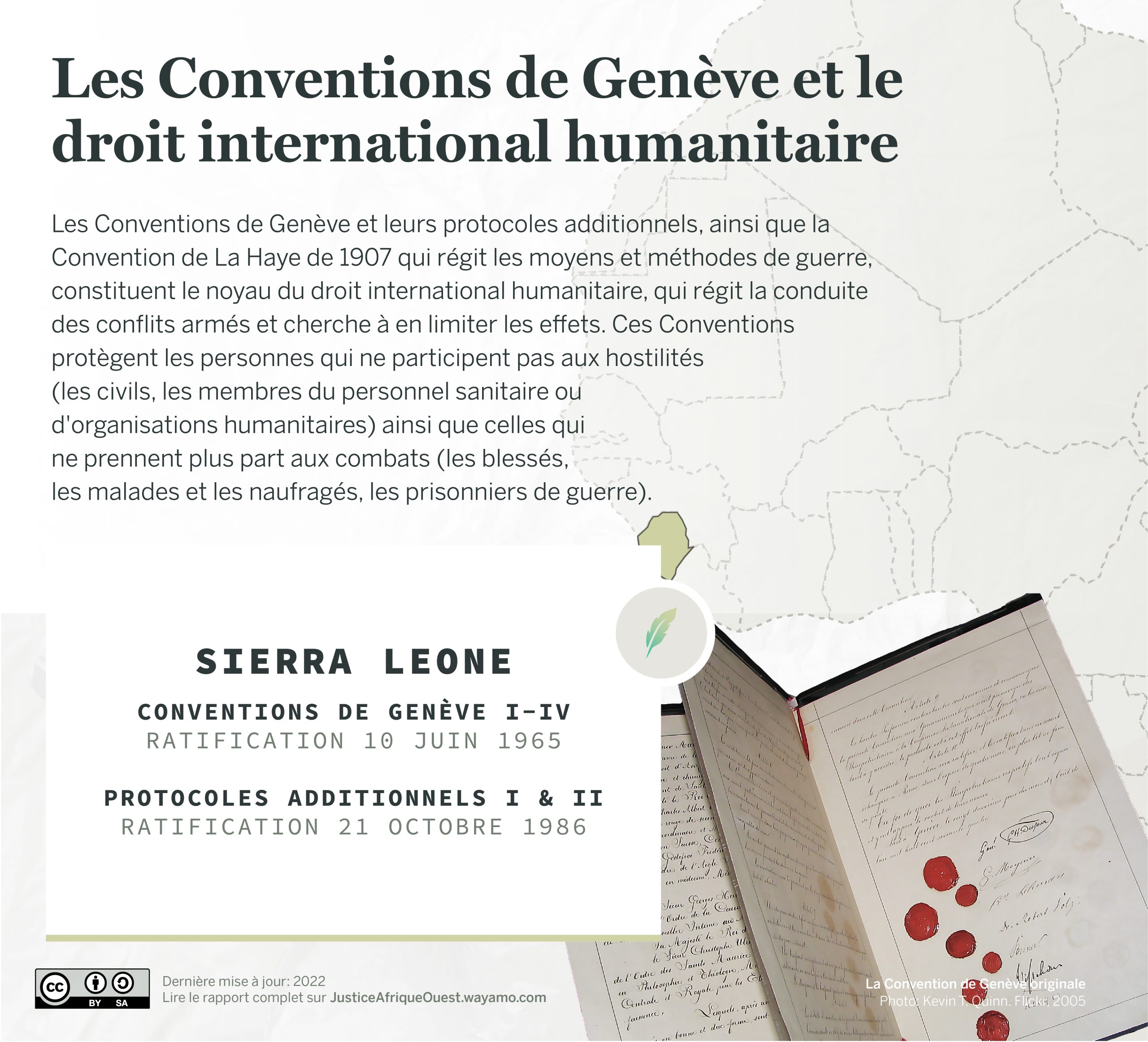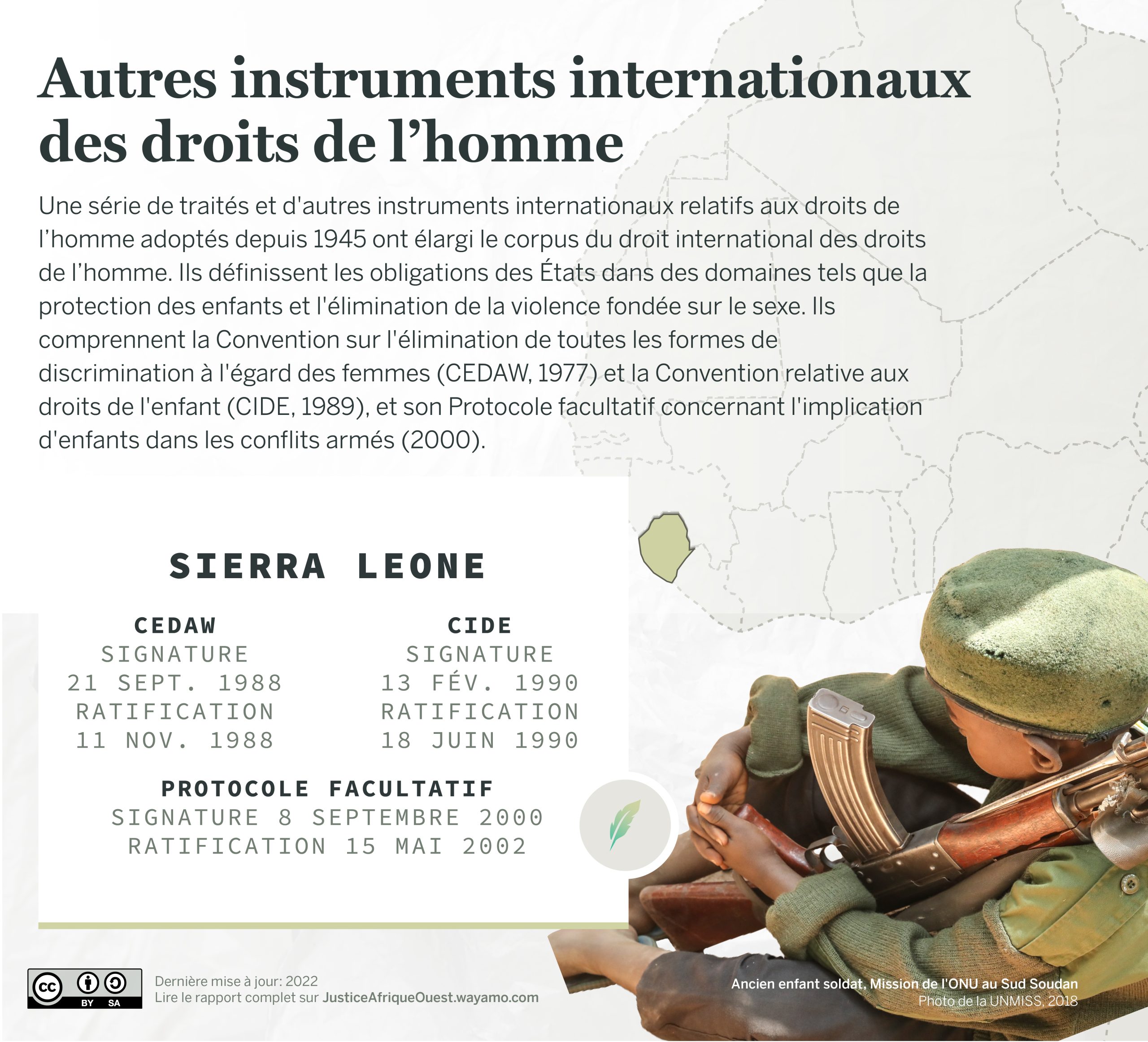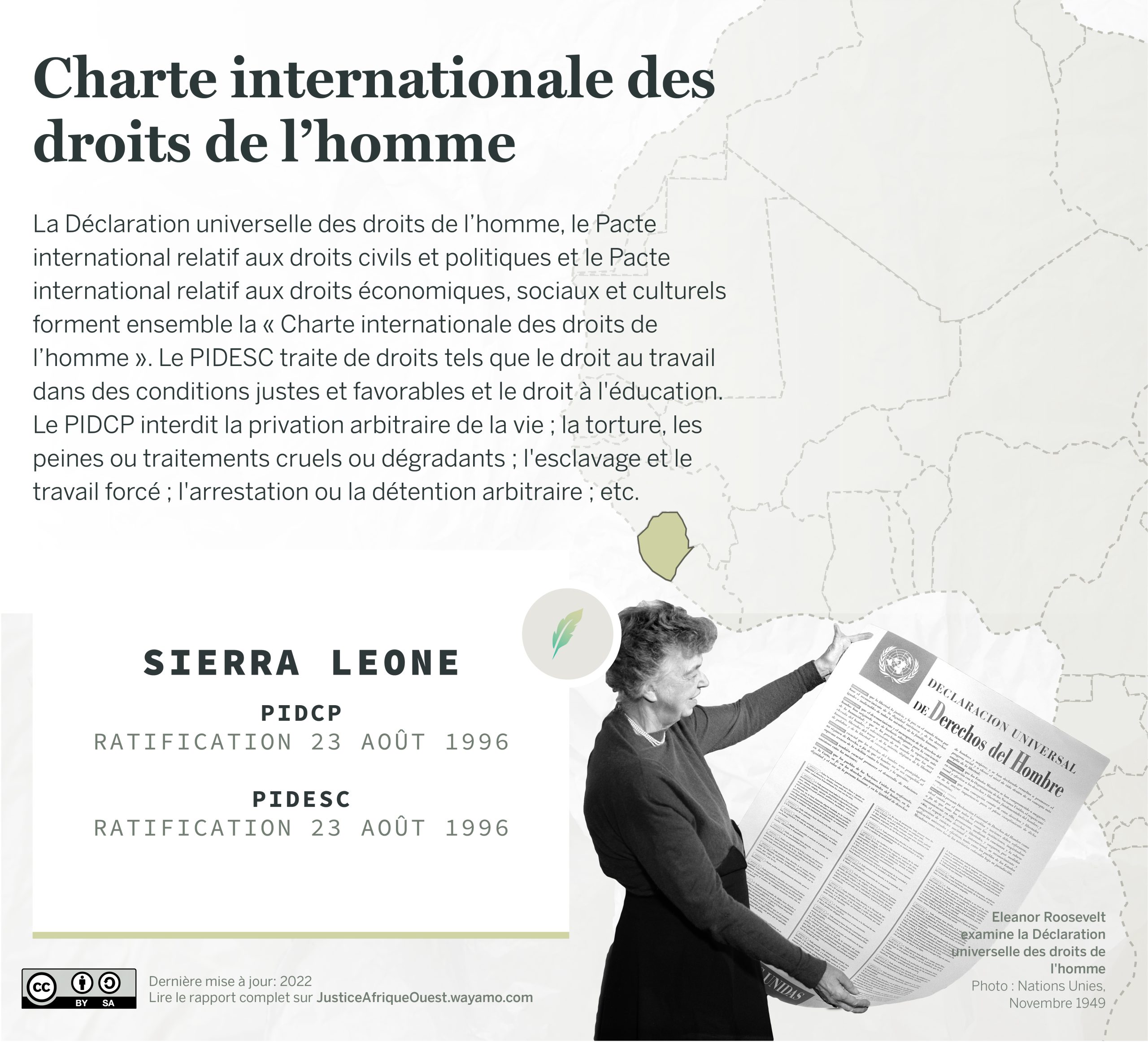Les affaires portées devant le TSSL
1. Le procès du Front révolutionnaire uni
Cinq dirigeants du RUF – Foday Sankoh, Sam Bockarie, Issa Sesay, Morris Kallon, et Augustine Gbao – sont mis en accusation devant le TSSL pour crimes internationaux. Les actes d’accusation contre Foday Sankoh et Sam Bockarie sont retirés par l’accusation en décembre 2003 à la suite de leur mort. Le procès des trois accusés restants s’ouvre à Freetown le 5 juillet 2004. Chaque accusé doit répondre de huit chefs d’accusation de crimes contre l’humanité, huit de crimes de guerre, et deux d’autres violations graves du droit international humanitaire. Les chefs d’accusation se rapportant aux atrocités commises contre des civils et des biens civils visent les actes suivants : terrorisme ; extermination ; esclavage sexuel et autres violences sexuelles, atteintes à la dignité de la personne ; enrôlement ou conscription d’enfants de moins de 15 ans ou leur utilisation pour les faire participer activement à des hostilités ; atteintes contre des membres de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL), notamment le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel employé dans le cadre d’une mission de maintien de la paix, le meurtre et la prise d’otages, entre autres infractions 22.
Le 25 février 2009, la Chambre de première instance juge Issa Sesay et Morris Kallon coupables de 16 des 18 chefs d’accusation de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et autres violations graves du droit international humanitaire, et Augustine Gbao coupable de 14 chefs d’accusation de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité 23. C’est la première fois qu’un tribunal international juge comme crime contre l’humanité le mariage forcé, et les attaques contre le personnel employé dans le cadre d’une mission de maintien de la paix. Les accusés sont condamnés à des peines d’emprisonnement en avril 2009 : 52 ans pour Issa Sesay, 40 ans pour Morris Kallon et 25 ans pour Augustine Gbao. Ils font appel du jugement, et le 6 octobre 2009 la Chambre d’appel infirme la déclaration de culpabilité prononcée contre Augustine Gbao au sujet du chef d’accusation 2 – punition collective comme crime de guerre – mais confirme les peines prononcées par la Chambre de première instance. Ils sont transférés à la prison de Mpanga au Rwanda le 31 octobre 2009 pour y purger leurs peines 24.
2. Le procès du Conseil révolutionnaire des forces armées
Le Conseil révolutionnaire des forces armées (Armed Forces Revolutionary Council ou « AFRC ») est composé de soldats de la SLA qui ont renversé le gouvernement du Président Kabbah le 25 mai 1997. Ils désignent le Major Johnny Paul Koroma, un officier retraité de la SLA, comme leur président et invitent le RUF à participer à une alliance dirigeante. Quatre dirigeants de l’AFRC – Alex Tamba Brima, Ibrahim Bazzy Kamara, Santigie Borbor Kanu, et Johnny Paul Koroma – sont inculpés par le TSSL et accusés de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et autres violations graves du droit international humanitaire25.
Les accusés sont remis au TSSL entre mars et septembre 2003. Johnny Paul Koroma fuit la Sierra Leone et n’est jamais jugé. Beaucoup croient qu’il est mort, mais son acte d’accusation reste ouvert jusqu’à ce que sa mort soit confirmée. Un acte d’accusation consolidé contre les trois autres accusés est approuvé en janvier 2004 et un procès conjoint s’ouvre en mars 2005. La Chambre de première instance juge les accusés coupables de 11 chefs d’inculpation sur les 14 retenus dans l’acte d’accusation. C’était la première fois qu’un accusé est jugé et déclaré coupable d’utilisation d’enfants soldats dans un conflit armé. Alex Brima et Santigie Borbor Kanu sont condamnés à 50 ans d’emprisonnement, alors qu’Ibrahim Bazzy Kamara est condamné à 45 ans 26. Les déclarations de culpabilité et les peines sont confirmées en appel. Les accusés sont transférés à la prison de Mpanga au Rwanda pour y purger leurs peines 27.
3. Le procès des Forces de défense civile
Les Forces de défense civile (Civil Defence Forces ou « CDF ») regroupent des milices locales pro-gouvernementales composées essentiellement de « Kamajors », chasseurs traditionnels sierra-léonais qui ont combattu pendant le conflit en Sierra Leone entre novembre 1996 et décembre 1999 28.
La Chambre d’appel ordonne la jonction des procès des trois dirigeants des CDF – Sam Hinga Norman, Moinina Fofana et Allieu Kondewa – en février 2004, et leur procès commence en juin de la même année. Les accusés doivent répondre de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et autres violations graves du droit international humanitaire. La présentation des conclusions finales devant la Chambre de première instance dans cette affaire se termine en novembre 2006, mais Sam Hinga Norman meurt avant que le jugement ne soit prononcé ; la procédure le concernant est donc clôturée en mai 2007 29.
Moinina Fofana et Allieu Kondewa sont déclarés coupables de crimes de guerre et Allieu Kondewa est déclaré coupable d’autres violations graves du droit international en août 2007. En mai 2008, la Chambre d’appel infirme une partie des déclarations de culpabilité, mais elle prononce également de nouvelles déclarations concernant certains chefs d’accusation et augmente la durée des peines prononcées contre les accusés. Moinina Fofana est condamné à 15 ans d’emprisonnement, et Allieu Kondewa à 20 ans. Le 28 mai 2018, Moinina Fofana finit de purger sa peine, cessant ainsi de relever de la compétence du Tribunal. Allieu Kondewa obtient une mise en liberté anticipée sous conditions en juillet 2018 et est autorisé à purger le restant de sa peine en Sierra Leone.
4. Le procès de l’ancien Président du Liberia – Charles Taylor
Le conflit en Sierra Leone est étroitement lié à celui du Libéria. L’ancien Président Charles Taylor est poursuivi par le TSSL pour avoir soutenu le RUF et l’alliance AFRC/RUF pendant le conflit. Il est poursuivi bien qu’il soit protégé de la compétence du Tribunal pour des raisons liées à l’immunité souveraine et à l’extraterritorialité 30. En juin 2003, au moment de la levée des scellés sur un acte d’accusation contenant 17 chefs dressé contre lui, Charles Taylor est toujours le président du Libéria. Le 11 août 2003 il quitte ses fonctions et part en exil au Nigeria, où il obtient l’asile.
Le 16 mars 2006, le TSSL approuve un acte d’accusation modifié à son encontre, réduisant le nombre de chefs d’accusation de 17 à 11. Parmi ces chefs d’accusation, cinq concernent des crimes de guerre (fait d’avoir terrorisé des civils ; meurtre ; atteintes à la dignité de la personne ; traitements cruels et pillage) ; cinq chefs d’accusation de crimes contre l’humanité (meurtre ; viol ; esclavage sexuel ; mutilation et sévices et réduction en esclavage) ; et un chef d’accusation d’autres violations graves du droit international humanitaire (recrutement et l’utilisation d’enfants soldats). Il est allégué que ces crimes ont été commis à divers endroits de la Sierra Leone et que Charles Taylor en est individuellement pénalement responsable pour les avoir planifiés et pour avoir apporté son aide et son concours à leur commission. Il est également allégué qu’en tant que supérieur hiérarchique, il est responsable des crimes commis directement par le RUF, l’AFRC et des combattants libériens. Le 26 avril 2012, la Chambre de première instance déclare Charles Taylor coupable des 11 chefs d’accusation retenus contre lui. Il est condamné à 50 ans d’emprisonnement, peine qui sera confirmée en appel 31. Charles Taylor purge sa peine au Royaume-Uni 32.