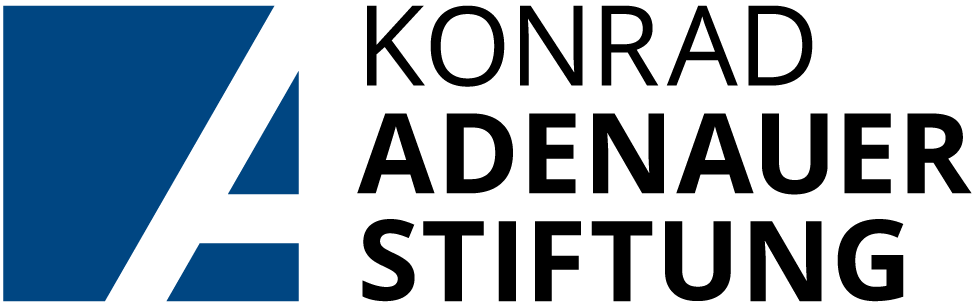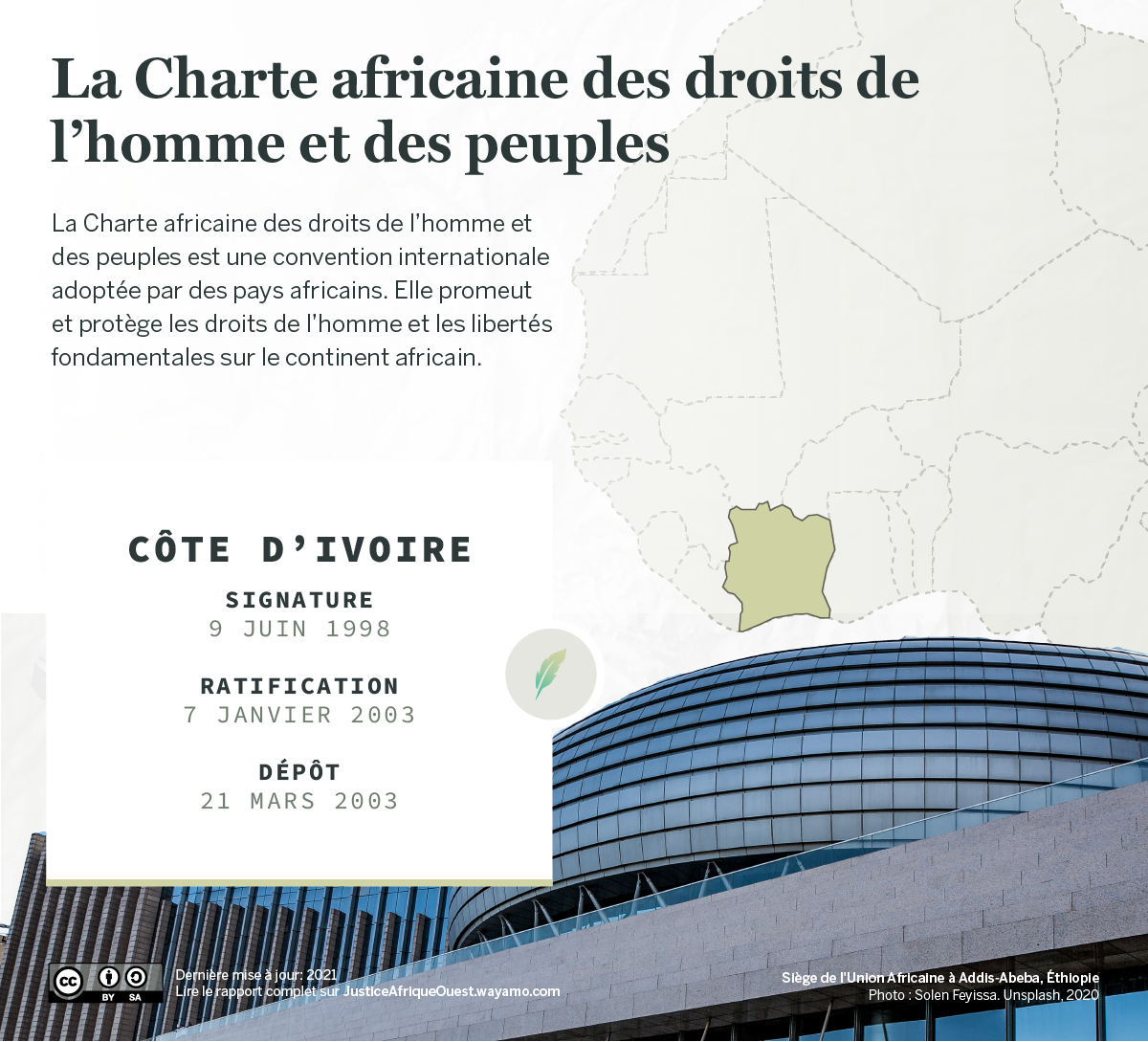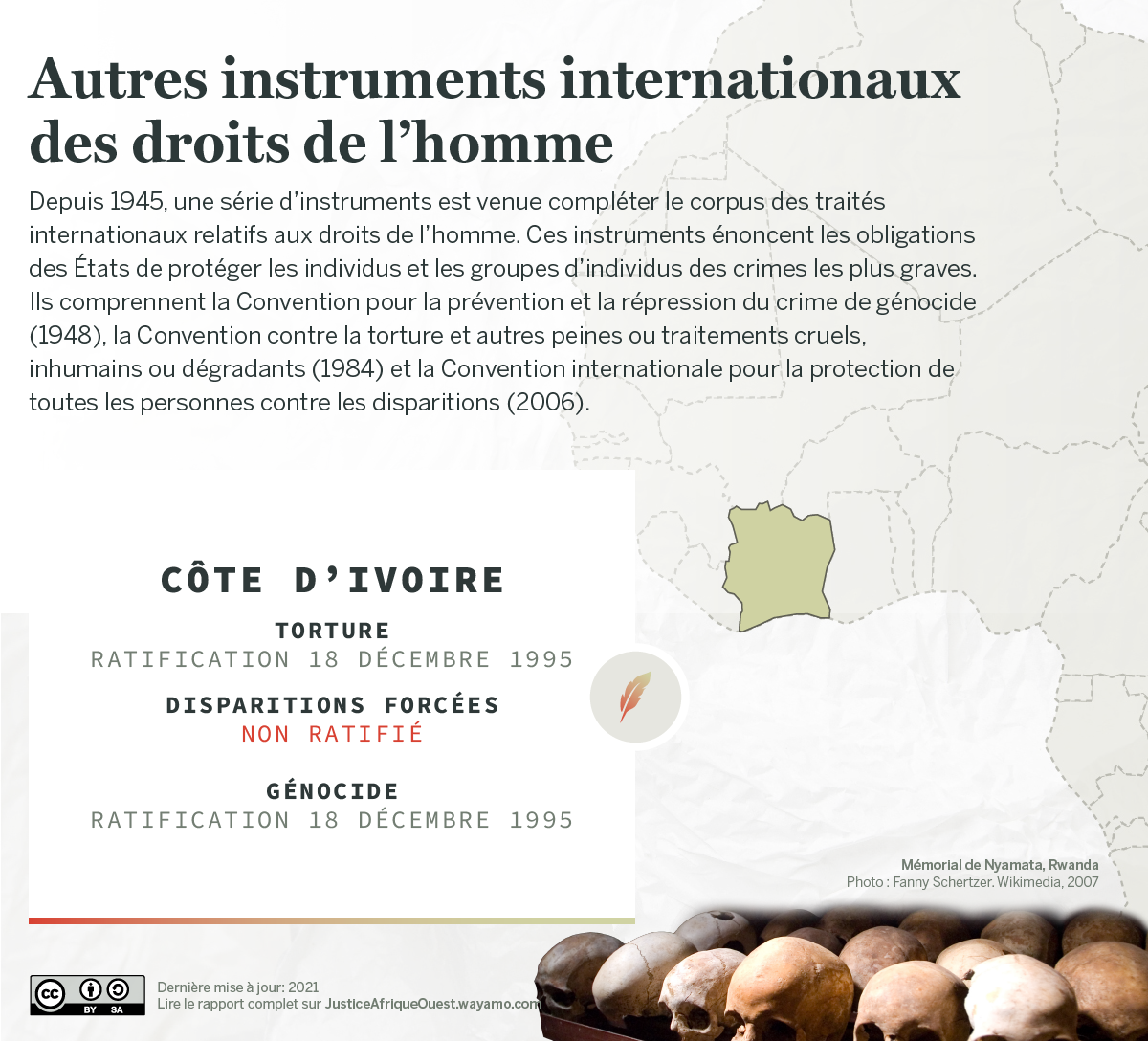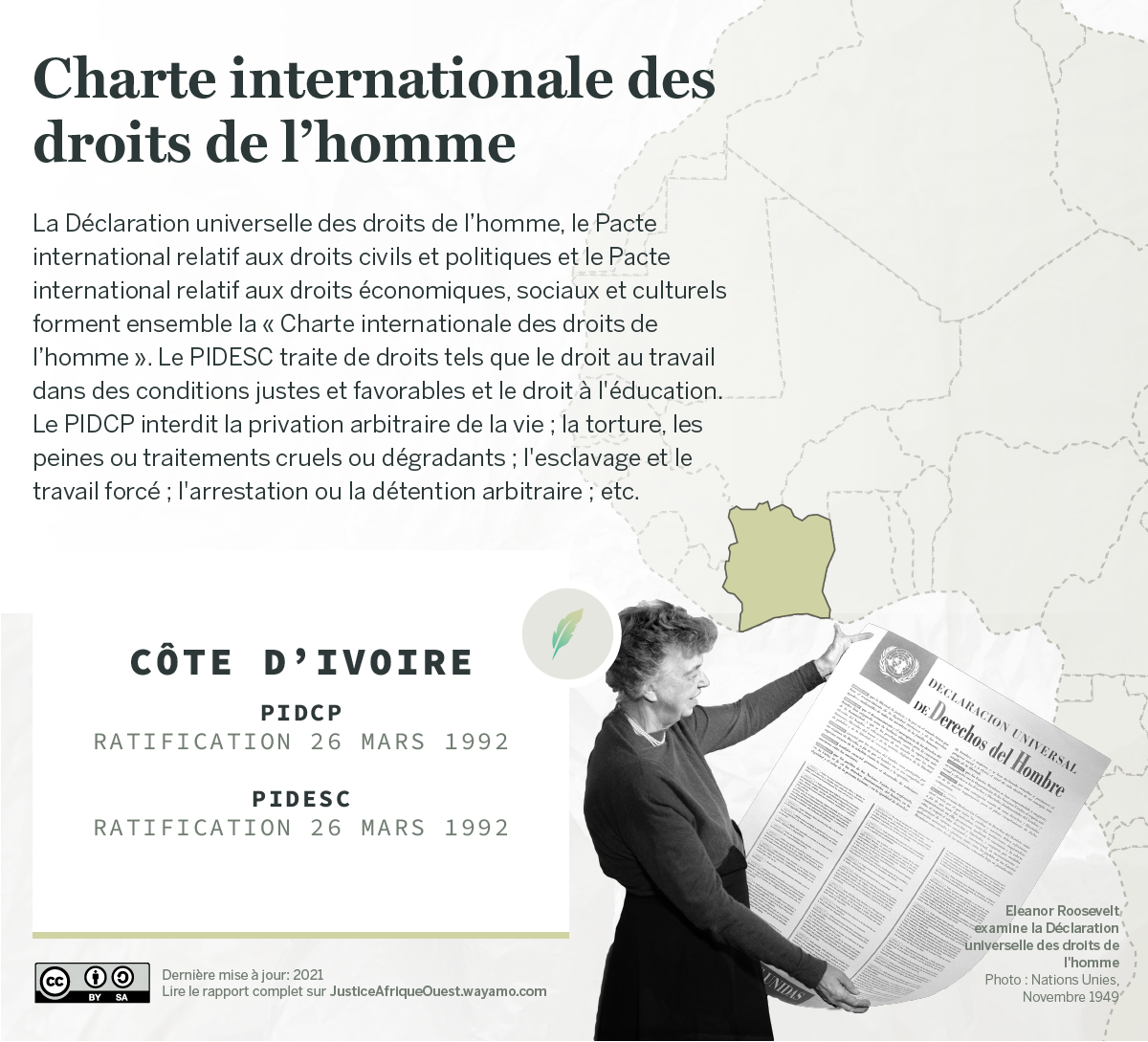Présidence de Laurent Gbagbo
Inauguration du Président Alassane Ouattara
Création de la Cellule Spéciale d'Enquête et de la Commission Nationale d'Enquête relatives à la crise post-électorale
Nationale d'Enquête relatives à la crise post-électorale
Créée en juin par décret ministériel, la Cellule Spéciale d'Enquête (CSE) est composée de magistrats, officiers de police judiciaire et greffiers. Elle est chargée d'enquêter sur les crimes et délits commis après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle le 28 novembre 2010. Ses enquêtes judiciaires se concentrent sur les crimes perpétrés pendant la crise post-électorale, à l'exception des cas relevant de la compétence du tribunal militaire.
- Document : FIDH « Côte d’Ivoire : La lutte contre l’impunité à la croisée des chemins » Octobre 2013, page 14
- Document : Arrêté interministériel portant création de la CSE
En juillet 2011, le gouvernement ivoirien crée la Commission Nationale d'Enquête. Cette commission administrative (non judiciaire) a pour mandat d’enquêter sur la crise post-électorale.
Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation
La Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR) est lancée avec pour mandat de créer les conditions de la réconciliation et de forger l'unité.
Cellule Spéciale d'Enquête et d'Instruction
La Cellule Spéciale d'Enquête et d'Instruction (CSEI) remplace la CSE. Au début du mois, le président Ouattara annonce que la Cellule Spéciale n'est plus nécessaire. Sous la pression des acteurs nationaux et internationaux, le gouvernement fait marche arrière et étend le mandat de la Cellule pour créer la CSEI.
Procès de Simone Gbagbo et de 82 co-accusés
Le procès de Simone Gbagbo et de 82 co-accusés s'ouvre à la Cour d'assises d'Abidjan. Le procès concerne à la fois les militants et les miliciens présumés qui ont soutenu Gbagbo, ainsi que les membres du dernier gouvernement de Gbagbo. Les accusés sont jugés pour crimes contre l'État (« atteinte à la sureté de l'État ») et non pour crimes internationaux. Les groupes de défense des droits de l'Homme critiquent la procédure, affirmant que les avocats de la défense n'ont pas eu accès aux dossiers de leurs clients, que les témoins ne sont pas fiables, que la protection des témoins est insuffisante et que les enquêtes sont incomplètes. (OIDH 2015)
Procès en relation avec le rapport de la Commission Nationale d'Enquête (CNE)
Vingt personnes auraient été poursuivies par la CSEI en relation avec le rapport de la CNE. Les enquêtes portent sur des crimes commis par toutes les parties et conduisent à l'inculpation de huit militaires pro-Ouattara. Les partisans de Ouattara inculpés sont toujours en poste et, en 2020, aucun d’entre eux n’a été jugé.
Verdicts pour Simone Gbagbo et les 82 co-accusés
Le tribunal rend des verdicts différents. Simone Gbagbo est condamnée à 20 ans de prison, soit le double de la peine demandée par le procureur. Les observateurs de la société civile jugent les verdicts sévères étant donné les lacunes de l'enquête et la faiblesse des preuves présentées. Suite au mandat d'arrêt de la CPI émis contre Simone Gbagbo, des accusations de crimes de guerre ont été ajoutées pendant le procès en Côte d’Ivoire.
Création d'une Commission de réparation
La Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes (CONARIV) est créée par ordonnance présidentielle pour mener à bien le processus de réparation des victimes parallèlement au Programme National de Cohésion Sociale (PNES). La CONARIV a pour mandat de produire une liste consolidée de toutes les victimes de la crise ivoirienne et de superviser la mise en œuvre du programme de réparation.
Mandat de la CSEI élargi au terrorisme
Un communiqué du gouvernement annonce la décision du Conseil des ministres d'adopter un décret étendant le mandat de la CSEI pour y inclure le terrorisme.
La Côte d’Ivoire adopte une nouvelle constitution
Les affaires nationales se poursuivent
Le rapport de l’expert indépendant des Nations Unies sur le renforcement des capacités et la coopération technique avec la Côte d’Ivoire dans le domaine des droits de l’Homme, constate qu'en décembre 2016, 17 affaires liées à la crise post-électorale sont en instance, 31 des 66 affaires ont déjà été jugées, 29 dossiers se trouvent devant la chambre d’accusation et 6 dossiers sont en instance de jugement devant la cour d’appel.
Un Général condamné à 18 ans
Le Général Bruno Dogbo Blé, ancien commandant en chef de l'armée, est condamné à 18 ans de prison pour arrestations et détentions illégales, assassinat, disparitions forcées et enlèvement de corps.
Un ancien ministre de Gbagbo condamné
Assoa Adou est condamné à quatre ans de prison et à une amende de 200 000 francs CFA pour trouble à l'ordre public, en vertu de l'article 169 du tribunal pénal. Le tribunal a ajouté ce chef d'accusation, qui n'existait pas dans les accusations initiales.
La Cour Suprême annule l’acquittement de Simone Gbagbo
Le 18 mars 2017, Simone Gbagbo poursuivie pour crimes contre l’humanité est acquittée par la Cour d'assises d'Abidjan, mais en juillet 2018, cette décision est annulée par la Cour Suprême. Des problèmes d'équité du procès sont soulevés ; notamment le fait que ses avocats aient suspendu leur participation lorsque le président du tribunal a refusé de convoquer des témoins considérés comme essentiels pour sa défense, à savoir cinq hauts fonctionnaires, dont le président de l'Assemblée nationale.
Les chefs rebelles jugés par contumace
L'ancien chef rebelle Guillaume Soro est jugé par contumace. Il est condamné à 20 ans de prison et de privation des droits civiques pour détournement de fonds publics et blanchiment d'argent. Il s'agit du premier procès et de la première condamnation d'un auteur présumé de crimes graves à l’encontre des partisans de Ouattara. Les accusations portées contre lui n'étaient pas liées au conflit.