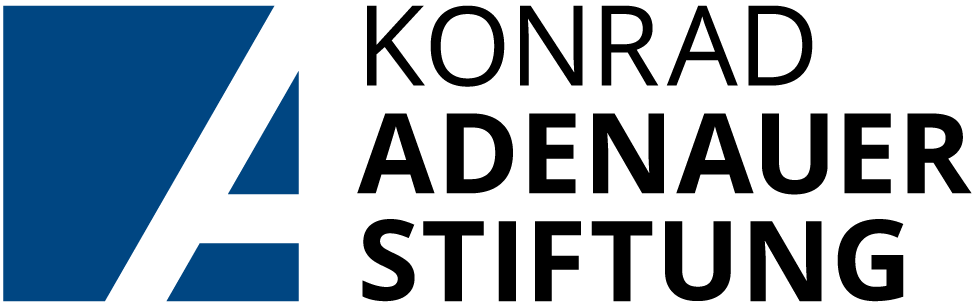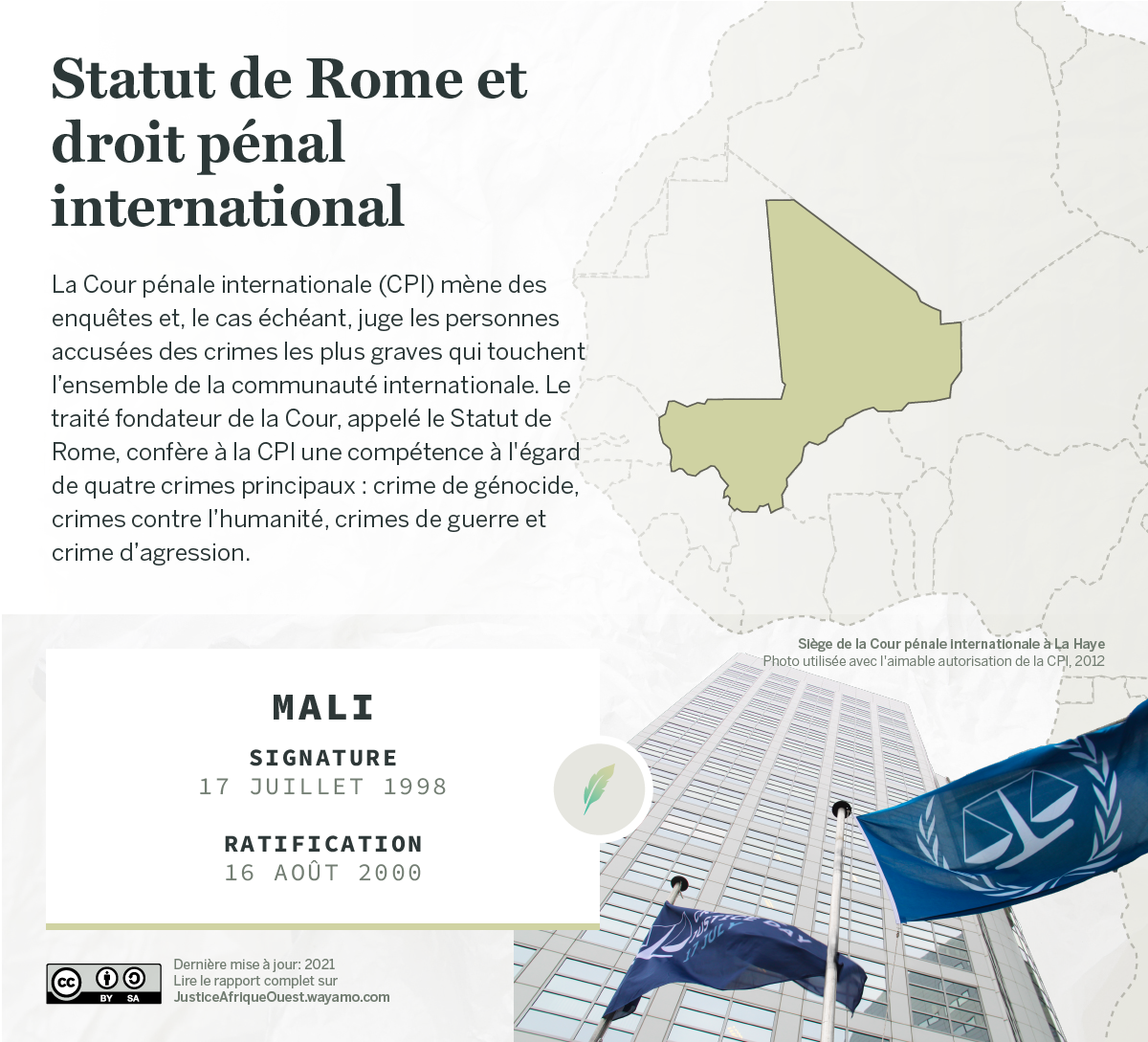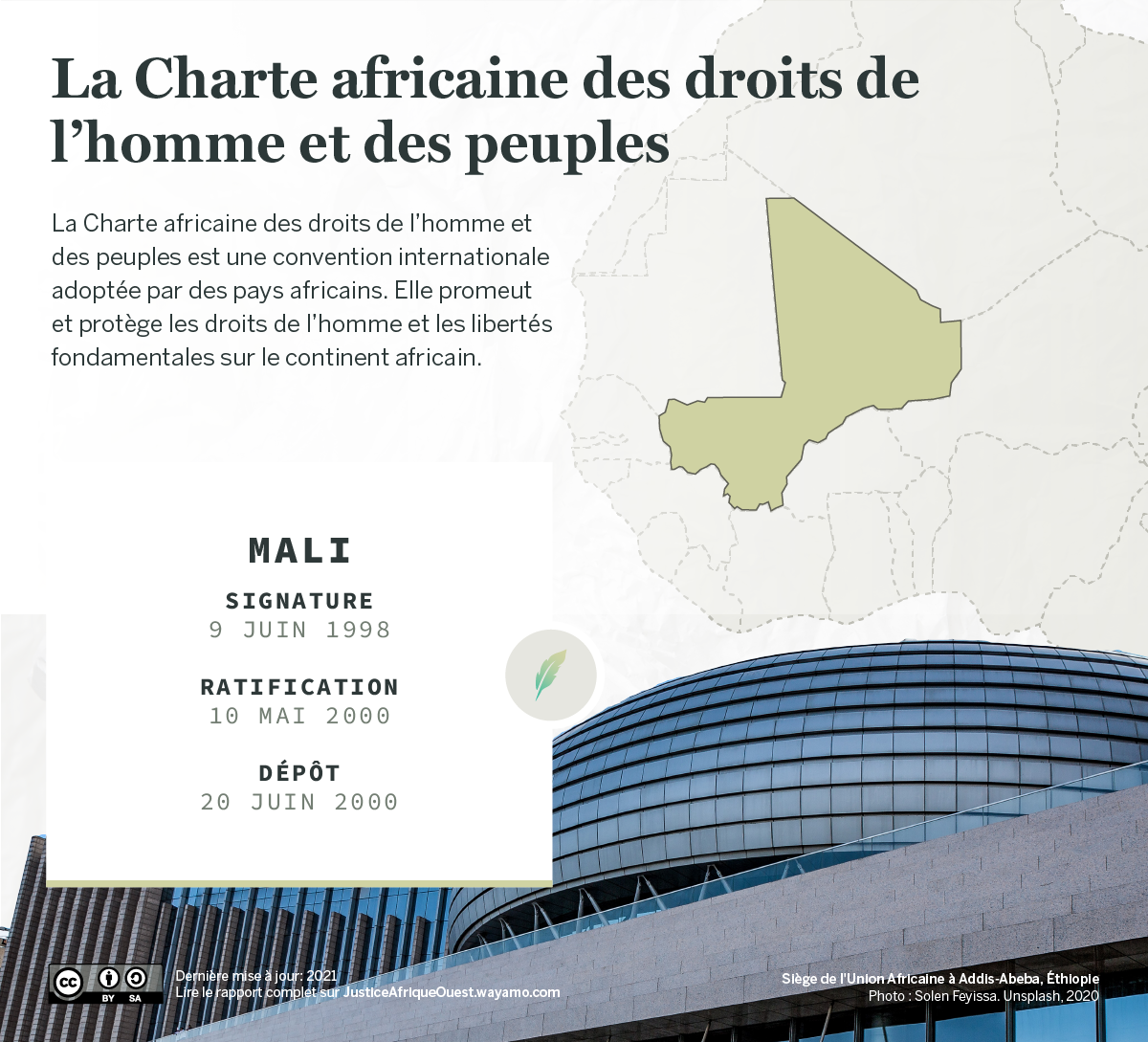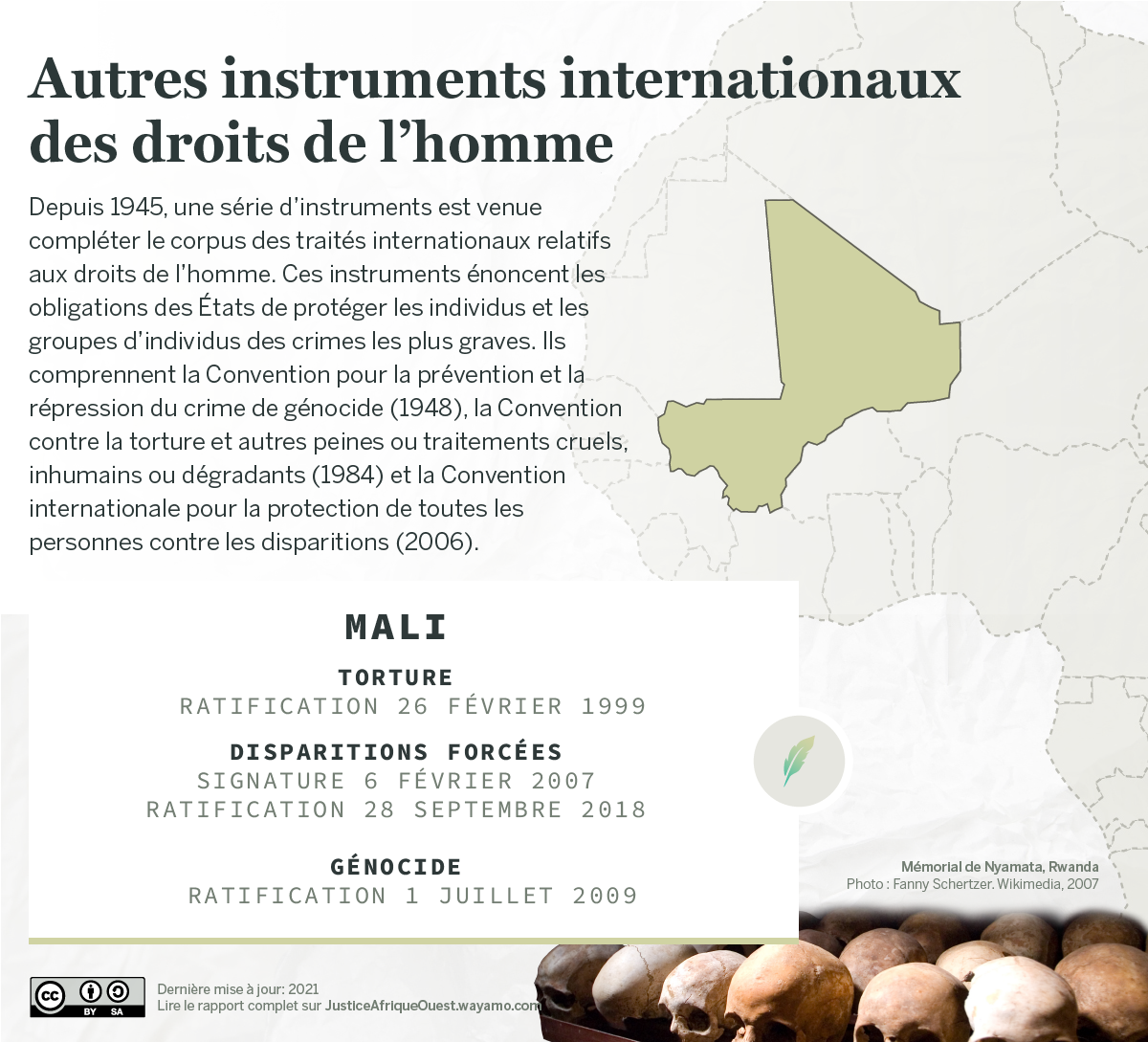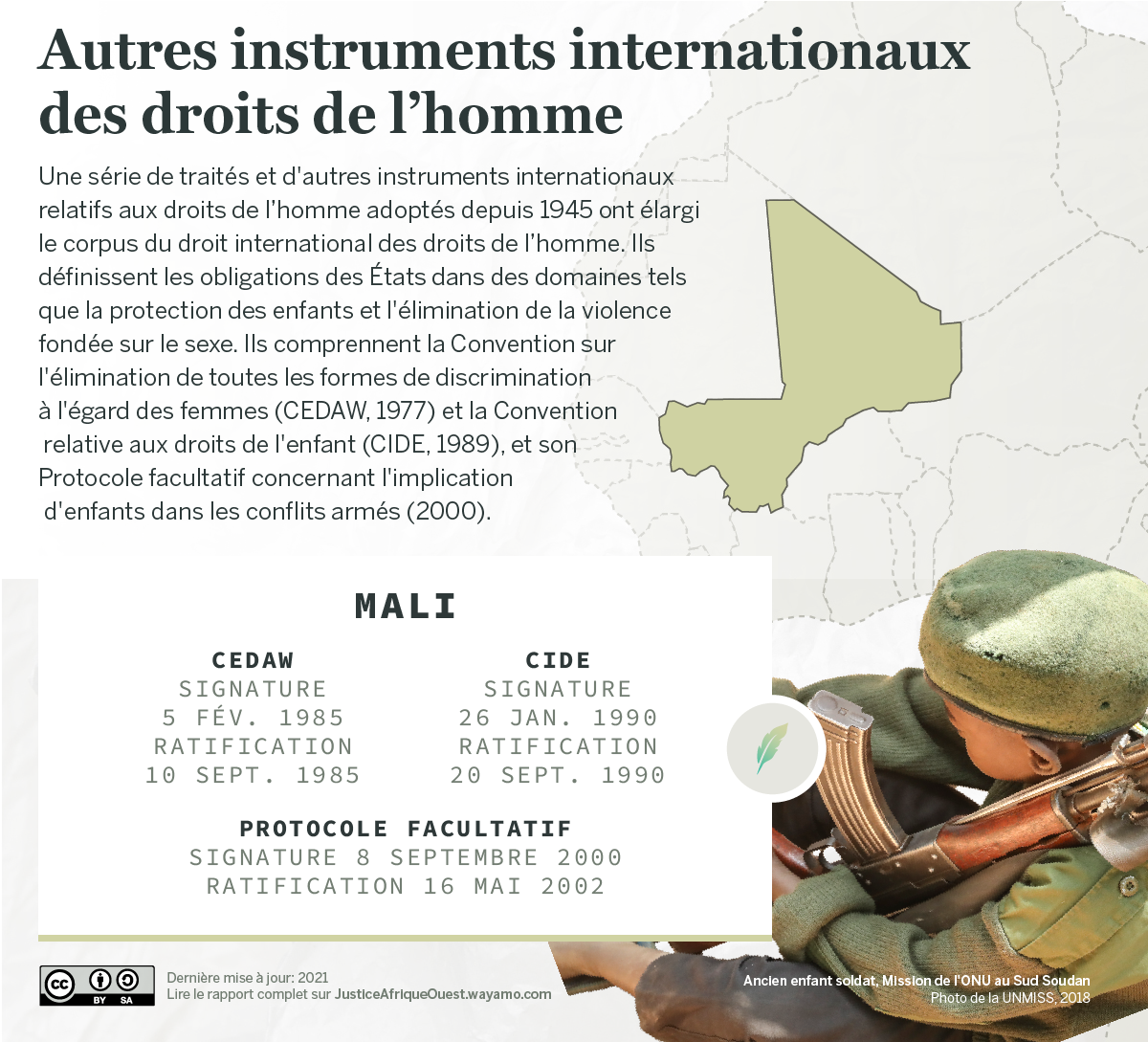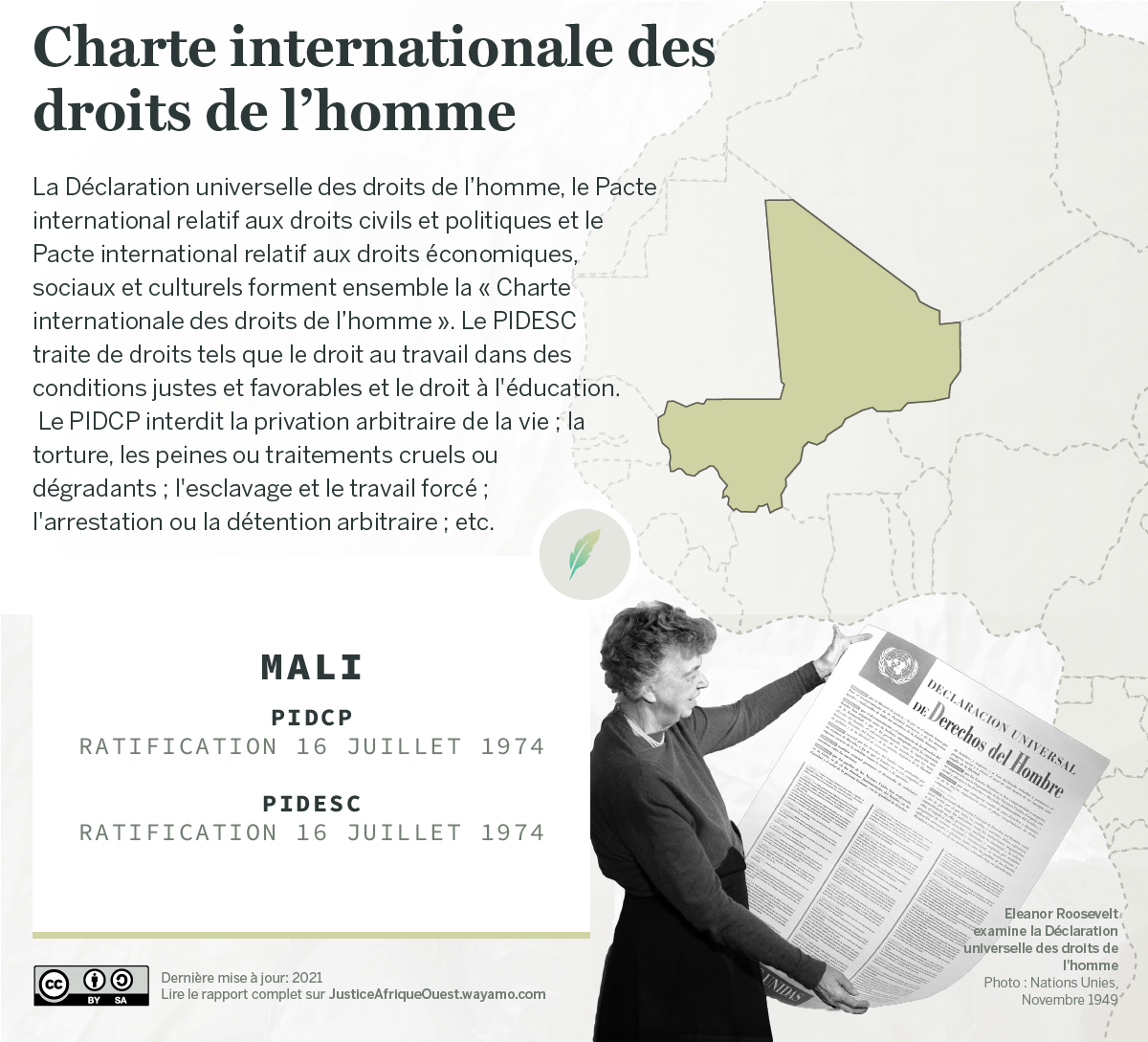Des combats éclatent à Bamako
Les forces pro-junte au Mali prennent le contrôle de la principale base militaire anti-junte après deux jours de combats dans la capitale, Bamako. Les membres des Bérets rouges (unité de la garde présidentielle) sont enlevés par les forces fidèles à Sanogo.
La CEDEAO menace de réimposer des sanctions
Le Président attaqué par des manifestants
Le Président par intérim, Dioncounda Traore, est conduit à l'hôpital pour blessure à la tête après avoir été attaqué par des manifestants pro-militaires le 14 mai 2012. Le Premier ministre Cheick Modibo Diarra démissionne après son arrestation par des soldats le 10 décembre 2012.
Avril 2012 - janvier 2013
Occupation de Tombouctou et d'autres villes du nord
Dans les mois qui suivent, le MNLA perd le contrôle de la plupart du territoire au profit de ses anciens alliés, les groupes islamiques Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), Ansar Eddine et le Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO). L'AQMI et Ansar Dine occupent Tombouctou et le MUJAO occupe Gao. Sous leur règne, des violations généralisées des droits de l'Homme sont commises, notamment des exécutions extrajudiciaires, des tortures, viols systématiques et mariages forcés, visant en particulier les enfants.
Les forces françaises reprennent le nord
Les forces françaises et leurs alliés expulsent l'AQMI et Ansar Eddine de Tombouctou en janvier et reprennent le nord en mai au cours de l'opération Serval.
Le Procureur ouvre une enquête contre Iyad Ag Ghali et 29 autres personnes
Le Procureur général du Mali ouvre une enquête pour les crimes commis pendant l'occupation du nord de 2012 à 2013, contre Iyad Ag Ghali, le chef du mouvement terroriste Ansar Dine, et 29 autres personnes. L'affaire concerne notamment l'ancien président du tribunal islamique de Tombouctou, Alfousseyni Ag alias « Houka Houka ».
Création de la MINUSMA par l'ONU
En avril, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) est mise en place pour soutenir la transition vers la paix.
- Document : Création de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), Résolution 2100 du Conseil de sécurité
Création d’un pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme au Mali
Les autorités maliennes adoptent une loi modifiant le Code de procédure pénale et créant un pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme au sein du Tribunal de Grande Instance de la Commune IV du District de Bamako. La compétence du pôle, définie à l’article article 609-1 de la loi de 2013, comprend les infractions liées au terrorisme, au financement du terrorisme, au blanchiment d'argent, au trafic de stupéfiants, d'armes et de munitions, ainsi qu'à la traite des êtres humains et aux pratiques connexes lorsque ces crimes sont de nature transnationale.
- Document : Loi de 2013 portant sur la création du pôle spécialisé
- Document : Loi n° 08-025 du 23 juillet 2008 qui détermine et réprime les actes de terrorisme et leur financement
Ibrahim Boubacar Keïta élu Président
Les premières élections présidentielles ont lieu le 28 juillet 2013, suivies par un second tour le 11 août.
Libération de Ag Alfousseyni « Houka Houka », Ben Gouzzoi et d’autres membres
Des membres de haut rang de groupes armés sont libérés afin de faire avancer le processus de paix et d'obtenir la libération des otages français.
La FIDH et l'AMDH portent plainte pour violences sexuelles
La Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) et l'Association malienne des droits de l'homme (AMDH) déposent une plainte pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre au nom de 80 femmes et jeunes filles victimes de viols et autres formes de violences sexuelles commis pendant l'occupation du nord du Mali en 2012 et 2013. Malgré la bonne volonté du juge d'instruction, l'enquête est bloquée en raison du manque de coopération des autorités et de l'insécurité dans le nord du pays.
Le pôle judiciaire spécialisé prend ses fonctions
Le gouvernement et les groupes séparatistes signent un « Accord Pour la Paix et la Réconciliation au Mali Issu du Processus d'Alger»
Les mandats d’arrêt contre plusieurs hauts responsables de groupes armés de l’affaire Ministère public contre Iyad Ag Ghaly et 29 autres, sont levés en mai et juin 2015. Au moins 50 auteurs présumés de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre sont libérés. Malgré ces actions, le processus de paix établit un cadre juridique pour la paix et la justice, permettant notamment des procès pour crimes internationaux et la création d’une Commission vérité.
Les victimes de l'occupation de Tombouctou portent plainte
La FIDH dépose une plainte, au Mali, au nom de 33 victimes de crimes internationaux commis pendant l'occupation de Tombouctou et de sa région par des groupes armés en 2012 et 2013. Cette plainte concerne 15 auteurs présumés de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. La procédure est suspendue en raison du manque de volonté politique et judiciaire.
Le Général Amadou Sanogo et 17 coaccusés sont jugés pour l'enlèvement et le meurtre de 21 Bérets rouges
Le premier procès pour crimes internationaux s'ouvre au Mali. La Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bamako accuse le général Amadou Haya Sanogo et 17 autres personnes, du meurtre de 21 Bérets rouges lors d'une tentative de contrecoup d'État. La Chambre les renvoie devant la Cour d'assises pour enlèvement et meurtre. Le premier examen médical des corps retrouvés dans le charnier de Diago n’ayant pas été effectué conformément aux procédures prévues par la loi malienne, la Cour ordonne un nouvel examen médical. Le procès est retardé.
La Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR)
La Commission vérité du Mali entame un ambitieux mandat qui a pour objectif d'enquêter sur les crimes commis entre 1960 et 2015 (mandat étendu plus tard aux crimes commis jusqu’en 2019).
- Document : Mandat de la CVJR
Un chef de police condamné pour terrorisme
Aliou Mahamar Touré, chef de la police islamique pendant l'occupation de Goa, est condamné pour actes terroristes constitutifs de crimes contre l’Etat. Il n'est pas accusé de crimes de guerre ni de torture, bien qu'il soit accusé de multiples actes de mutilation.
Le pôle spécialisé enquête sur 162 affaires
Environ 120 procédures judiciaires antiterroristes sont lancées en 2017, mais presqu’aucune n’aboutit à un procès. Cela fait suite à une douzaine de condamnations prononcées par le tribunal pénal de Mopti en avril 2016 en l'absence des accusés. Les affaires les plus importantes sont toujours en cours d'instruction.
Adoption de la loi qui étend la compétence de pôle spécialisé aux crimes de guerre, génocide et crimes contre l'humanité
Procès liés aux attaques intercommunautaires sur Koro, Bankass et Baniagara
Les suspects accusés d'avoir mené les attentats de 2019 à Koro, Bankass et Bandiagara sont jugés à la Cour d'assises de Mopti. Sur les 60 accusés, 44 sont condamnés, mais seuls deux d'entre eux sont reconnus coupables de meurtre.
Le pôle spécialisé enquête sur le massacre intercommunautaire d'Ogossagou
L'enquête sur le massacre du 23 mars de 160 éleveurs peuls à Ogossagou, dont plus de la moitié étaient des enfants, conduit à dix arrestations.
Le pôle spécialisé enquête sur le massacre intercommunautaire de Sobane Da
Le procureur du pôle spécialisé ouvre une enquête sur le massacre d'au moins 95 membres de la communauté Dogon à Sobane Da en juin 2019. En octobre 2019, neuf suspects sont placés en détention préventive.
Enquête sur les attentats intercommunautaires Koulogon
La Haute Cour de Mopti ouvre une enquête sur le massacre de 37 personnes le 1er janvier à Koulogon. Douze individus sont soupçonnés d'être liés à ces massacres, et huit d’entre eux sont libérés par la suite.
Quatre hommes de la communauté Dogon condamnés pour des attaques intercommunautaires sur Bankass Cerle
Nouvelle loi sur la protection des témoins
Afin de combler les lacunes en matière de protection des témoins et des victimes, deux projets de loi sur la protection des témoins sont préparés par des organisations de la société civile malienne et proposés aux autorités. L'un de ces projets de loi concerne en particulier les violences sexistes, y compris la protection des victimes de violences sexuelles. Un troisième projet de loi concernant la protection des « défenseurs des droits de l'homme » est initié par le Ministère de la Justice et présenté à l'Assemblée nationale fin 2020.
Démission du Président Keita après un coup d'État
Suite à l'escalade des violences après les élections parlementaires de mars et avril 2020 et des mois de protestations, un groupe de soldats séquestre plusieurs fonctionnaires du gouvernement, dont le président Ibrahim Boubacar Keïta qui démissionne et dissout le gouvernement.
Bah Ndaw devient Président du Mali
Le Colonel Bah Ndaw, 70 ans, ancien Ministre de la défense sous Ibrahim Keita, assume la présidence jusqu'aux élections prévues 18 mois plus tard. Le Colonel Assimi Goïta, chef du Comité national pour le salut du peuple (CNSP), qui a organisé le coup d'État du mois d'août, est nommé vice-président.
Les charges contre le général Sanogo sont abandonnées
La cour d’assises de Bamako ordonne la fin du procès contre le général et ses co-accusés, qui étaient jugés pour l’assassinat de 21 militaires en 2012.
Bah Ndaw est renversé par Assimi Goïta
L'armée malienne, dirigée par le vice-président Assimi Goïta, arrête le président Bah Ndaw qui démissionne. Goïta devient président par intérim le 7 juin 2021. Il s'agit du troisième coup d'État du pays en dix ans.